|
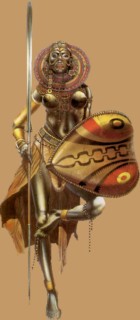
Curiosités
suite
La
légende
de
Mamiwata:
Les
Africains
se sont
inspirés
des
figures
de proue
sur les
navires
qui
étaient
sensés
apporter
l'abondance
pour en
faire
une
déesse
bienfaisante,
mais
l'histoire
et les
drames
qui
l'accompagnent
l'ont
transformé
en
créature
mythique
maléfique,
mais
(comme
c'est
souvent
le cas)
super
canon
!!!!
"Mami
Wata,
mother
water:
la mère
des
eaux, la
sirène,
la
déesse
hybride,
femme-poisson
apparue
et
vénérée
en
Afrique
au
moment
de la
rencontre
entre
Blancs
colonisateurs
et Noirs
bientôt
colonisés.
Objet
d'un
culte
qui se
répand
bientôt
dans
toute
l'Afrique
occidentale
et
centrale,
elle
devient
la
déesse
préférée
des
"femmes
libres"
des
villes
africaines
postcoloniales,
fait
l'objet
de rites
propitiatoires,
de magie
noire et
de
sorcellerie,
mais est
aussi
source
d'espérance
en une
vie
meilleure.
Symbole
de ces
femmes
libres
qui
effraient
et
fascinent...
Mais
alors me
direz
vous
vous ,
d'où
vient
l'origine
du mot
Mamiwata
? anglo
saxone
ou
réellement
de la
tradition
africaine
?
Pour
l'exemple,
Mamiwatta
illustre
parfaitement
les
pièges
de cette
vision
fondée
mais
quelques
fois
trop
rapides
des
emprunts
africains,
souvent
abusivement
interprétés
comme
des
signes
de
déficiences
linguistiques
autochtones...
La
plupart
des pays
africains
situés
sur les
côtes
occidentales
du
continent,
aux
abords
des
fleuves
et même
des
rivières
à
l'intérieur
du
continent
et dans
sa
diaspora
américaine,
accordent
une
certaine
importance
à
Mamiwatta,
cette
déesse
mi-poisson
mi-humaine
réputée
dotée de
pouvoirs
magiques,
susceptibles
d'entretenir
des
relations
amoureuses
avec les
terriens.
La
figure
de
Mamiwatta
est
aussi
associée
à un
mythe,
un
imaginaire
populaire
très
fécond
et très
ancien
se
perdant
dans la
nuit des
temps,
sans
rien
céder de
sa place
dans les
croyances
populaires,
profanes
ou
sacrées.
Le lien
entre
cette
divinité
de
l'eau,
bienfaitrice
et
protectrice
et sa
consonance
anglo-saxonne
a vite
été fait
et
considéré
solide.
Mamy et
water
renvoyant
à mère
et à
eau,
s'accordent
en
superficie
plutôt
bien
avec
l'idée
que l'on
se fait
de
Mamiwatta.
Une
sirène
des mers
!!
Selon le
chercheur
Basile
Goudabla
Kligueh
qui a
passé
plus de
20 ans à
travailler
sur le
Vodu,
Mamiwatta
chez les
Adza-Tado,(
peuples
répartit
entre le
Togo, le
Benin et
le
Ghana,
principalement
Evé et
Fon),
vient de
« Ma mi
ata »
signifiant
«je
ferme la
jambe»
ou «ma
mi wo
ata» qui
veut
dire «je
ferme ta
jambe»
chez les
Evé.
D'où
Mamiwatta
ou Mami
Ata. En
fait
l'adepte
de
Mamiwata
,est
soumis à
un
régime
sexuel
d'interdit
quand il
doit
recevoir
la
visite
de la
sirène
qui
prend
une
apparence
humaine.
Il doit
donc
«fermer
ses
jambes»,
« ma mi
ata »,
sous
entendu
s'abstenir
des
plaisirs
amoureux
sur le
plan
physique.
Il lui
revient
aussi de
«fermer
les
jambes»
de son
partenaire
terrestre,
«ma mi
wo ata»
signifie
«je
ferme
tes
jambes».
Selon
Goudabla
Kligueh,
maître
Vodu, la
relation
avec
Mamiwata
est
telle
que le
Mamisi
(l'homme)
qui ne
respecterait
pas
l'interdit
de
l'abstinence
sexuelle
le jour
dédié à
la
Sirène
encours
le
risque
d'impuissance
sexuelle
ou de
rapports
sexuels
perturbés
avec son
partenaire.
On dit
alors
que
Mamiwata
«ferme
les
jambes»
du
partenaire
du
Mamisi.
Une
infécondité
pourrait
en
découler.
Le champ
sémantique
des
évocations
de
Mamiwata
chez les
Adza-Tado,
les
prières
adressées
à la
divinité
mentionnent
les
«jambes»
et les
«bras»
que les
adeptes
lui
attribuent.
Mami wo
ata,
«celle
qui fait
les
jambes»,
«Mami wo
abo»,
celle
qui fait
les
bras,
paroles
de
rituels
désignant
la
Sirène
expriment
respectivement
l'idée
que le
génie se
fabrique
des
jambes
pour
rejoindre
son
conjoint
terrestre,
et
l'idée
de
l'attribut
de
fécondité
reconnu
à
Mamiwata,
car
faire
des
jambes
et faire
des bras
est une
métaphore
de
fabriquer
un
enfant.
L'étymologie
populaire
des Evé
et des
Fons
d'Afrique
de
l'Ouest
rend
donc
parfaitement
compte
de
l'idée
que l'on
se fait
de
Mamiwata,
divinité
des eaux
et
concubine
invisible
mi-femme
mi-poisson,
sans
recours
à une
langue
d'importation.
Pourtant
la
consonance
Mamy
Water
aurait
suggéré
spontanément
une
origine
non
africaine
du mot
et
peut-être
du
culte.
Un cas
éclairant
parmi
tant
d'autres
!! A
vous de
voir
!!!!



 |